L'écriture, un cadeau de la civilisation islamique à l'humanité
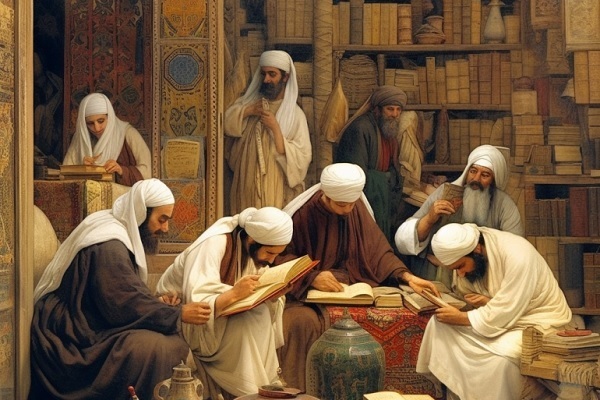
Le phénomène de l'écriture et de la calligraphie - l'industrie de l'édition de livres dans les sociétés islamiques - est l'un des phénomènes les plus importants que la civilisation islamique ait offert à la civilisation humaine, et avec son développement et ses progrès, a conduit à l'abondance de livres et à la création de bibliothèques publiques et privées. Elle a également créé le patrimoine scientifique le plus riche de l’humanité jusqu’à l’époque moderne, et a prospéré avec l’invention de l’imprimerie en 1450, par Johann Gutenberg.
Le premier siècle de l'Hégire a été le siècle de la narration orale des textes islamiques (Coran et Sunna) et de la langue arabe, et la compilation des sciences et des connaissances qui en découlent n'a été observée que dans quelques cas.
Au début du deuxième siècle de l’Hégire, connu comme l’époque de la compilation, les sciences, la période de transmission orale a pris fin. Il était nécessaire de placer ces sciences dans un cadre solide afin qu'elles soient transférées et protégées de la destruction, et héritées entre les générations.
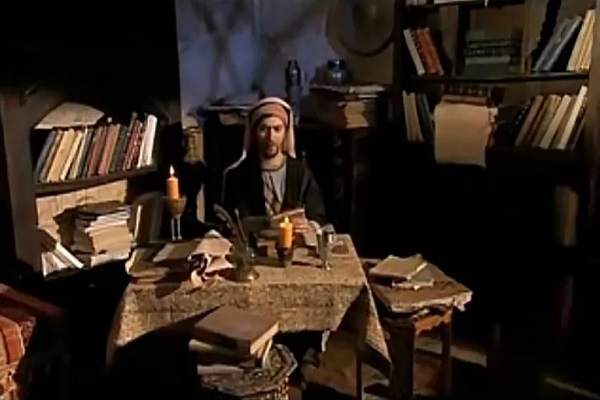
Les conquêtes musulmanes ont conduit à la fusion de différentes civilisations et à l’émergence de différentes cultures dans des pays comme l’Irak, la Perse, la Syrie et l’Égypte, et des débats controversés et des discussions culturelles et scientifiques ont eu lieu dans ces régions.
À cette époque, on observait la nécessité de traduire d'autres langues vers l'arabe, et d'adapter leurs méthodes de raisonnement, de sorte que le marché de la traduction a prospéré au point où les traductions étaient réalisées à partir de plus de 10 langues. L'activité de compilation et de publication de manuscrits s'est également développée.
L'essor de l'écriture et de l'édition était dû à la position élevée des scribes des tribunaux à partir de la période omeyyade, et à leur importance croissante à l’époque abbasside. Deuxièmement, l’utilisation du papier dans l’écriture, à cette époque, a conduit à la construction de la première usine de papier à Bagdad, sous le règne de Harun al-Rashid, dans les années 70 du IIe siècle.
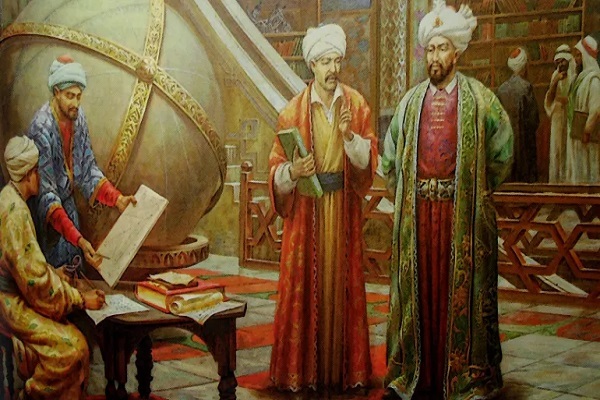
De cette façon, les gens se sont familiarisés avec l'industrie de l'écriture sous ses deux formes, la rédaction et la traduction, et cette industrie est rapidement devenue l'une des industries de la civilisation islamique, connue sous le nom de « Warraghi ».
Dans cette industrie, un grand groupe de scribes de différentes couches intellectuelles et littéraires de la société, et des religieux se sont spécialisés et ont établi des règles et des principes pour ce travail et des marchés lui ont été attribués, les propriétaires de cette industrie faisant beaucoup de bénéfices.
D'un point de vue historique, l'écriture en tant que profession, était au début liée à la copie du Coran pour gagner de l'argent. Ibn Nadim a écrit dans son livre Al-Fahrest que « les gens écrivaient les Mushafs en échange d'un salaire ». A cet égard, il a inscrit les noms de certaines personnes dans la catégorie des écrivains de Mushaf.
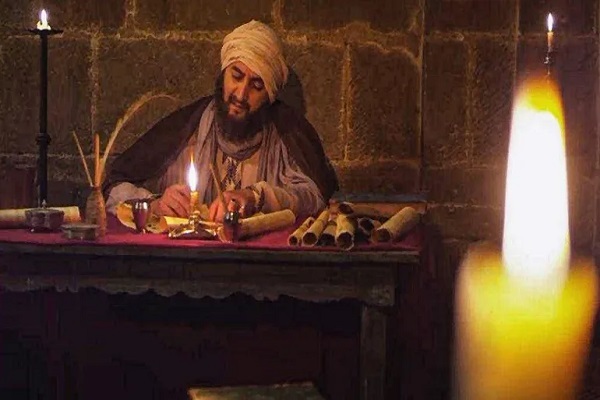
Ibn Nadim, citant l'historien Muhammad Ibn Ishaq a écrit : « La première personne qui a écrit des Mushaf au premier siècle de l'Hégire – et était connue pour sa calligraphie – était Khalid Ibn Abi Al-Hiyaj qui était le scribe du calife Walid bin Abdul Malik, décédé en 716.
Mais la première personne qui reçut le titre de « Warraq » - le chef des scribes - est Abu Raja Matar bin Tahman Khorasani Basri décédé en 748, et connu sous le nom de « Matar al-Warrak ». Jamal al-Din al-Muzhi a écrit dans le livre « Tahzib al-Kamal » qu'il vivait à Bassora et rédigeait des Mushaf.
Son contemporain était Masawar bin Suwar bin Abdul Hamid Kufi, décédé en 768, connu sous le nom de « Masawar al-Waraq ». À propos de sa biographie, Aladdin Moghlatai bin Qalich a écrit dans « Akmal Tahzib al-Kamal » qu'il était l'un des transmetteurs de Hadiths.
Au milieu du 8e siècle, la collecte de hadiths prophétiques et des fatwas des compagnons et disciples, ainsi que les progrès de la langue arabe et ses poèmes s'ajoutèrent également à la copie du Coran.
Parmi les premiers ouvrages dont les textes nous sont parvenus sous une forme documentée, le livre « Al-Muta » de l'Imam Malik Ibn Anas décédé en 795, « Le livre des règles religieuses » de l'Imam Shaféite décédé en 795, « Al-Mabsut » de l'Imam Muhammad bin Hasan Shaybani décédé en 805, « Al-Kitab » traité de grammaire arabe par Sîbouya, décédé en 795, « Le livre de grammaire arabe » de Souyuti décédé en 795, le dictionnaire « Al-Ain » de Khalil bin Ahmad Farahidi Azdi décédé en 791 et le «Mu'allaqât » recueil de poèmes arabes.



